
Gabriel Yared a débuté avec Jean-Luc Godard (Sauve qui peut la vie, 1981), Jean-Jacques Beineix (La Lune dans le caniveau, 1983 - 37.2 le matin - et sa première nomination aux César en 1987), avant de s'imposer comme l'un des compositeurs de musique de film français les plus demandés à l'étranger depuis sa collaboration avec Anthony Minghella (5 films) dés "Le Patient Anglais" et son Oscar remporté en 1996. Il est aussi associé aux comédies de Jean-Pierre Mocky (Agent trouble), à des films d'animation (pour René Laloux - Gandahar, et Michel Ocelot - Azur et Asmar).
Cinezik : Parlons de votre collaboration avec Jean-Luc Godard sur SAUVE QUI PEUT LA VIE en 1980, votre première musique de film. Godard a la réputation de tout contrôler : quelle a été votre part de liberté ?
Gabriel Yared : Vous ne connaissez pas la petite histoire ? J’ai rencontré Jean-Luc dans un bistrot à Saint-Cloud, sur la recommandation de Jacques Dutronc, qui connaissait mes travaux pour Françoise Hardy. Il m’a fait une blague en me disant que Godard cherchait un compositeur « classique »… Or, je suis un autodidacte ! Mais Dutronc, par humour et aussi peut-être parce qu’il ressentait en moi certaines capacités qui sommeillaient, m’a recommandé à Godard. Je le rencontre, je lui demande si je peux voir quelque chose : il me répond que ce n’est pas nécessaire. Il avait déjà choisi quatre mesures de l’Ouverture de l’Acte 2 de LA GIOCONDA, un opéra de Ponchielli (un musicien « vériste » de l’époque de Verdi). Cet opéra, très peu de gens le connaissent, mais dans l’ouverture de l’Acte 2, entièrement instrumentale, il y a un très beau thème, une sorte d’arpège descendant, à partir duquel Godard m’a demandé d’explorer les quatre premières mesures tout au long du film. On était fin 1979, je sortais d’une période d’orchestrations à tout va pour des chanteurs de variété français, italiens ou même brésiliens. Alors je lui ai dit franchement : « si c’est encore pour faire des orchestrations sur un thème, ça ne m’intéresse pas » et je suis parti !
Le producteur m’a rappelé, étonné que j’aie décliné une offre de Godard, mais j’ai tenu bon dans ma détermination : « si vous voulez un orchestrateur, allez en chercher un, moi je veux faire de la composition »… J’étais alors à une période de ma vie où je voulais tout recommencer à zéro car malgré mon expérience intuitive de l’écriture ,je ressentais le besoin d’étudier et d’approfondir le contrepoint. Jusqu’alors, au lieu d’acheter une maison ou un appartement avec mes honoraires d’orchestrateur, j’investissais tout en achat de partitions dans lesquelles j’apprenais en lisant les grands classiques. J’avais 30 ans, et j’avais décidé de prendre une année sabbatique pour apprendre d’une manière plus académique le contrepoint, la fugue et l’harmonie. Godard est arrivé à ce moment-là. Je ne le connaissais pas - à l’époque j’avais une culture cinématographique très bancale ! - Mais Godard a aimé ma sincérité. Il m’a écrit un mot : « j’ai beaucoup aimé notre conversation, parlons-en, parlons-nous ». On s’est revu, et Godard m’a dit : « je ne veux pas vous « coincer » avec ce thème, mais c’est une base, exploitez-là ». L’idée de partir d’une cellule musicale, de tourner autour et d’en tirer tout le suc, tout en restant soi-même, et finalement, faire une œuvre qui se tient, m’a plu. J’ai pris ça comme une sorte de challenge, de défi. J’ai finalement tiré quarante minutes de musique des quatre mesures de Ponchielli, sans même le citer véritablement… J’ai appris une chose : le thème n’a pas beaucoup d’importance, c’est ce qu’on en fait qui l’est, comment on arrive à l’encadrer, à l’explorer. Bizarrement, je n’ai vu le film de Godard qu’une fois la musique terminée ! Elle avait épousé l’esprit du film, sans forcément suivre plan par plan les images. Quand cette rencontre est réussie elle tient, bien sûr, à ce qu’a su faire passer dans son discours et dans son approche le réalisateur…
On ne peut pas écrire une musique en trois mois à la fin du processus de production, et réussir de cette manière à être en phase avec le travail d’un réalisateur qui porte le film en lui depuis deux ou trois ans.
Que retenez-vous de votre « période synthé », comme dans MALEVIL ou GANDAHAR ? Que vous a-t-elle apporté ?
Je crois avoir été l’un des premiers compositeurs à utiliser des échantillons dans une musique de film , en l’occurrence MALEVIL. Je me sers toujours du synthétiseur, des échantillonneurs d’une certaine manière. J’ai toujours considéré les synthés et les échantillonneurs - même quand ils avaient un son « bidon » comme en 1981 ! - comme des instruments nouveaux, et non des outils créés pour remplacer l’orchestre. Sur MALEVIL, je pensais que les timbres de l’orchestre traditionnel ne convenaient pas au sujet : la bombe atomique avait éclaté, nous sommes dans un petit village où ont survécu cinq ou six personnes. Quel pouvait être le « son » après la bombe atomique ? J’ai injecté dans le Fairlight des sons que j’avais trouvés sur certains de mes disques LP de musique ethnique, j’ai moi-même soufflé pour faire du vent, j’ai trouvé un petit bout de Kanoun (un instrument oriental à cordes qui se joue avec des onglets)… Bref, j’ai créé mon propre « orchestre », qui ne rentre pourtant pas en concurrence avec la nomenclature habituelle de l’orchestre traditionnel composé de cordes, de bois et de percussions… J’avais besoin de sons nouveaux pour créer l’esprit particulier de ce film. Il y a aussi la question des moyens qui peut influencer le choix car écrire et enregistrer avec un orchestre entraîne des coûts très élevés. Mais les sons que vous entendez dans MALEVIL ou SARAH ne sont pas en remplacement de l’orchestre : ils sont un univers à part. Je n’ai pas tourné le dos à cette manière de faire de la musique, ce sont les occasions qui m’ont amené à écrire pour des orchestre classiques. Mais j’ai toujours aimé les mélanges. Dans SARAH, il y a un quatuor à cordes, un piano, et aussi des synthés et le mariage est formidable. Dans HANNA K, il y a un orchestre symphonique avec des musiciens orientaux et aussi des synthés ; instruments traditionnel et outils électroniques, l’un ne remplace pas l’autre…

Continuons avec votre collaboration avec Jean-Jacques Beineix, qui comme Claude Lelouch en son temps, a essuyé les foudres des critiques, notamment pour LA LUNE DANS LE CANIVEAU : comment l’avez-vous ressenti ?
J’avais écrit, pour MALEVIL, quarante minutes de musique, mais à l’image,le réalisateur n’a utilisé que cinq minutes. Il ne m’a pas compris, la production non plus : tout le reste a été balayé, ils trouvaient la musique trop étrange. Un jour, Dutronc m’a invité au Grand Echiquier, l’émission de télévision de Jacques Chancel, et j’ai joué en direct mes œuvres : un thème de SAUVE QUE PEUT LA VIE et un autre de MALEVIL, avec un petit orchestre et un synthé. Jean-Jacques Beineix regardait cette émission et il m’a plus tard appelé. Je l’ai rencontré huit mois avant le tournage de LA LUNE DANS LE CANIVEAU à Cineccita, et il m’a donné le scénario, car lui aussi aimait bien l’idée que je commence à composer avant les images. Il avait également besoin de maquettes avant de tourner, notamment pour la scène où Gérard Depardieu entre dans le bar et où Beineix voulait qu’on entende le thème du film. J’ai donc écrit très tôt les thèmes principaux du film. D’ailleurs, le tango qu’on entend dans le disque est resté tel qu’on l’entendait dans la maquette. Outre le violon et le bandonéon, le reste c’est du synthé et c’est moi qui joue… Ce que j’ai aimé chez Beineix, c’est qu’il m’a demandé de nourrir son tournage - pendant toutes les répétitions à Cineccita, ma musique était diffusée sur le plateau - et non pas de venir « habiller » un film déjà terminé.
Pourtant, Sergio Leone travaillait déjà comme ça avec Ennio Morricone…
Mais je ne le savais pas, à l’époque ! Je faisais tout ça naturellement, sincèrement ! Je n’avais aucune culture cinématographique à ce moment-là de ma vie ! J’ai appris plus tard que Rota travaillait aussi comme ça avec Fellini, que Hermann travaillait comme ça avec Hitchcock… Je me suis inscrit dans un courant où la relation à l’écrit et avec le réalisateur est plus importante que la relation à l’image. Une fois que l’image est là, c’est très facile de « coller » mais ce n’est pas la synchronisation qui fait la musique de film, c’est l’esprit qui l’habite.
Pour en revenir à LA LUNE DANS LE CANIVEAU, ce fut pour moi une expérience magnifique : après que les maquettes aient été diffusées sur le tournage, j’ai écrit ce que je considère comme l’une de mes musiques les plus importantes, car c’est un véritable mélange entre le symphonique et les échantillonneurs. Pour une scène dans les docks j’avais demandé à Pierre Gamay, l’ingénieur du son du film, de me ramener de Marseille tous les sons qu’il pouvait : il enregistrait des caréneurs (les artisans qui travaillent sur les bateaux), les menuisiers qui travaillent sur les chantiers maritimes, il m’avait ramené des sons de marteaux, de scies… qui m’ont servi pour écrire « La Folie des Docks ». Il existe une version de la partition pour marteaux, et la même pour orchestre à cordes ! A l’époque, en 1981, je trouvais ça « révolutionnaire »… Pour le générique de fin, que nous avons enregistré au studio Davout à Paris, j’avais mis sur plusieurs pistes tous les thèmes du film, et au centre une boucle avec une harpe, le sermon d’un prédicateur et des chants d’oiseaux. J’ai injecté là-dessus, petit à petit, tous les thèmes du film, et c’est comme ça que le générique de fin de LA LUNE DANS LE CANIVEAU illustre magistralement ce mélange entre échantillons et musique orchestrale. Malheureusement pour Beineix, et malheureusement pour moi, l’accueil du film a été affreux : c’est tout juste si on n’a pas eu des tomates à Cannes… Je continue à dire que c’était un film très avant-gardiste, une sorte d’opéra non chanté. C’est ce que voulait Beineix.

Ensuite, c’est 37,2° LE MATIN…
Après ce « bide » presque total, Beineix me propose un autre projet, plus intimiste, 37,2° LE MATIN : il me fait lire le scénario, je lui demande de rencontrer les acteurs. J’ai donc rencontré Jean-Hugues Anglade, puis Béatrice Dalle, et on a convenu d’une scène très importante dans un magasin de piano, où Jean-Hugues Anglade et Béatrice Dalle se retrouvent chacun à un piano et jouent un duo. Même principe que dans LA LUNE DANS LE CANIVEAU : la musique devait précéder le tournage. Le thème du saxophone sur le manège avait donc été écrit avant, le thème aux deux pianos aussi. Et le chef opérateur, le décorateur, les deux acteurs principaux et le réalisateur se nourrissaient de cette musique avant le tournage ! Jean-Hugues Anglade me l’a encore rappelé : « c’est incroyable comme d’avoir déjà la musique en tête influence notre manière de jouer ». Et sans prétention, je pense que l’on a réussi ici une osmose entre le film et la musique, au point que beaucoup de gens se rappellent le film en écoutant la musique. C’est une musique qui a marqué, pourtant réalisée avec très peu de moyens : une guitare, un harmonica, un saxophone,des percussions et des synthés.
Sur quoi vous êtes-vous basé pour écrire le thème au piano de 37,2° LE MATIN ?
Sur les connaissances musicales de Jean-Hugues Anglade et de celles de Béatrice Dalle, sur leur capacité à jouer du piano. Quand Jean-Hugues Anglade est venu me voir, il m’a dit qu’il était en train de prendre des cours de piano. Je lui demande ce qu’il joue, et il me répond « Docteur Gradus Ad Parnassum », tiré de « Children’s Corner » de Debussy. Je demande à Béatrice Dalle ce qu’elle sait jouer, elle me répond : « que dalle » ! Elle tape quand même quelques note avec un doigt (NDLR : Gabriel joue au piano) et voilà, c’était tout trouvé ! J’ai gardé un placement des doigts identiques à « Docteur Gradus Ad Parnassum » pour Jean-Hugues, en y rajoutant des « notes bleues », c’est à dire des notes un peu « blues ». Pour elle, qui ne joue qu’avec un doigt, j’ai écrit un thème tout simple ,basé sur une gamme ascendante. Voilà l’origine de ce thème.

Pour GANDAHAR, vous n’avez malheureusement plus d’acteurs pour vous inspirer, puisqu’il s’agit d’un film d’animation ! Vous écrivez une partition à la fois poétique et exigeante : comment s’est passée votre rencontre avec René Laloux à l’époque du court-métrage WANG-FÔ en 1987 et votre collaboration avec lui sur ce long-métrage, un an après ?
J’ai eu beaucoup de chance avec René. Il se promenait dans un studio de post-production à Boulogne, je crois, et en passant près d’un studio il entend une musique. Il demande ce que c’est, et on lui répond que c’est du Yared (un jingle ou une publicité, je ne sais plus précisément). C’est comme ça que René, qui préparait WANG-FÔ et GANDAHAR, s’est mis en relation avec moi. Il y avait une réelle entente entre nous, une vraie harmonie sur tous les plans. Il me montrait les dessins de Caza, m’a montré son précédent film (LA PLANÈTE SAUVAGE, qui est une merveille) et il me disait : « voilà, vas-y ». Je demande avec quels moyens, il me dit « on n’a pas de moyens ! ». Donc j’ai tout fait au synthé. René venait au studio où je travaillais avec mon ami Georges Rodi tous les jours, il s’asseyait près de moi, on déclenchait la vidéo à la main, et j’improvisais à l’image devant le réalisateur à partir des thèmes que j’avais déjà écrit. Je n’avais pas de pudeur avec lui, il y avait une telle confiance, une telle estime pour ce que je faisais qu’il m’a vraiment propulsé dans une grande liberté créatrice. GANDAHAR est une partition très importante, même si elle est faite de synthés qui ont vieilli. A l’époque on ne parlait même pas d’échantillonneurs. Et pourtant cette musique est nourrie de thèmes et de mélodies. Pour le thème des « transformés », je voulais écrire un thème en hommage aux Chorals pour orgue de Bach. Il y en avait particulièrement un, que j’avais joué à l’orgue autrefois… (NDLR : Gabriel joue au piano). J’ai donc composé une sorte de choral, pour des sons très étranges, et un un thème principal. Ce n’était pas un dessin animé du genre à faire « pouet-pouet » (bien que j’adore ce qu’ont fait des compositeurs comme Scott Bradley et Milton Franklin pour les films de Tex Avery !), mais là c’était autre chose : comment écrire quelque chose avec des synthés et qui reflète les émotions des personnages animés? C’est donc une œuvre commune : tous les jours, on retravaillait la musique commencée la veille, jusqu’au moment où elle était synchrone avec l’image certes mais surtout avec la beauté des personnages et des dialogues.
Vous avez également collaboré avec Jean-Pierre Mocky pour AGENT TROUBLE et LES SAISONS DU PLAISIR en 1987 et 1988, puis sur NOIR COMME LE SOUVENIR en 1995 : il est réputé d’être un réalisateur tyrannique sur le plateau, mais l’est-il aussi avec son compositeur ?
Pas du tout ! Il faut le prendre de face, en quelque sorte. La première fois que j’ai vu Mocky, c’était par l’intermédiaire de mon agent, qui le représentait également. Il m’a parlé d’AGENT TROUBLE comme d’un film très léché, très travaillé, et Mocky souhaitait que j’en écrive la musique. J’ai donc rencontré Mocky, qui est un vrai personnage, et qui est très drôle ! Il me dit : « ah, mon cher Yared, j’aimerais que vous me fassiez de la musique un peu comme Bernard Herrmann ou Maurice Jarre, mais pour pas trop cher… ». Et moi je lui dis : « mais cher ami, Maurice Jarre est encore vivant, si vous avez besoin de lui, appelez-le ! ». Il me répond : « non, c’est une manière de parler, je veux quelque chose de très thématique, et aussi de très hermannien ». Je me suis tout de suite entendu avec lui et j’ai écrit le thème principal d’AGENT TROUBLE, avant que ne commence le tournage du film. Après, j’ai travaillé à l’image. C’était notre première collaboration ensemble et ça s’est bien passé. Quand une grande gueule rencontre une autre grande gueule, ça ne peut que bien s’entendre ! Je ne suis pas une grande gueule dans le sens « agressif », mais je veux qu’on m’aborde avec respect. J’aime les réalisateurs qui s’adressent avec respect à leurs assistants et autres collaborateurs sur les plateaux. Mocky est une grande gueule mais il n’est pas prétentieux, il a de l’amour en lui et beaucoup d’amitié pour toute son équipe. J’estime que le résultat sur AGENT TROUBLE est vraiment bien, c’est probablement son film le plus abouti, le scénario est bien écrit, c’est bien filmé. Ça n’a pas toujours été le cas chez lui, comme par exemple pour LES SAISONS DU PLAISIR…
J’ai été un grand admirateur des « Double Six », un groupe français créé vers la fin des années 50 qui reprenait des orchestrations de Dizzie Gillepsie ou de Count Basie et qui mettait dessus des textes, en chantant tous les solos de cuivres avec des textes d’une saveur extraordinaire écrits par Mimi Perrin. Je ne comprends pas que ce groupe ait pu tomber dans l’oubli. Je l’avais découvert pendant mon adolescence, et j’y trouvais une musicalité extraordinaire, et à l’époque des SAISONS DU PLAISIR, j’avais envie de voir si ce groupe existait encore. J’ai retrouvé Mimi Perrin, qui était à l’origine du groupe, et je lui ai proposé de regrouper six autres chanteurs pour le thème chanté des SAISONS DU PLAISIR. Chaque film est une occasion pour moi de retrouver mes grands amours et mes obsessions. Avoir trois des chanteurs des « Double Six » sur LES SAISONS DU PLAISIR en était une ! Et c’est Mimi Perrin qui a signé les textes.

Parlons maintenant de vos collaborations à l’étranger : vous avez collaboré par trois fois avec le cinéaste anglais Anthony Minghella…
Anthony Minghella est un italien de deuxième génération. Ses parents sont venus s’installer sur l’île de Wight et ont fondé une entreprise de glaces: les « glaces Minghella » sont désormais connues sur toute l’île de Wight ! Anthony est né là-bas. Il était destiné à travailler dans l’entreprise familiale mais ce qu’il voulait faire, c’était monter un groupe et faire de la chanson… Il a suivi des études de lettres et il a commencé à écrire des pièces pour la BBC, avant d’enseigner la littérature et d’arriver au cinéma. Alors certes ses films sont produits aux USA, mais c’est bien un italo-anglais et il aime le cinéma européen.
Que ce soit avec LE PATIENT ANGLAIS, LE TALENTUEUX MONSIEUR RIPLEY ou COLD MOUNTAIN, chacune de vos partitions pour Minghella est honorée de nombreux prix… Que retenez-vous de cette fructueuse collaboration ?
C’est vrai qu’il y a eu des prix à chaque fois… Je retiens surtout une fraternité d’âme, une fraternité de goûts. Je ne passe jamais autant de temps sur une musique de film que sur celles de Minghella. A titre d’exemple, j’ai commencé son nouveau film, BREAKING & ENTERING, en avril 2005. On est aujourd’hui en mars 2006, et nous n’avons pas encore fini… LE PATIENT ANGLAIS représente dix mois de travail, tandis que MONSIEUR RIPLEY et COLD MOUNTAIN presque un an chacun. Chaque scénario m’emmène ailleurs, ne me permet pas de m’installer dans des habitudes. Entre LE PATIENT ANGLAIS et MONSIEUR RIPLEY, il n’y a pas parenté dans la musique, les ambiances sont complètement différentes. Chaque horizon est différent, chaque film est nouveau. Entre nous, il y a une confiance et une compréhension totale : un simple thème joué au piano est éloquent pour lui…
Il est musicien : il a un piano chez lui, il connaît tous les préludes de Bach (il est autant passionné de Bach que je le suis !), on a donc en commun cet amour de la beauté en musique, de la belle architecture musicale, et de la rigueur musicale. Il est venu vers moi parce que c’était un fou de 37°2 LE MATIN, et il adorait L’AMANT. Ça faisait longtemps qu’il voulait travailler avec moi. Pour son premier film américain, MR. WONDERFUL, il a demandé à Warner Bros de travailler avec Gabriel Yared. On lui a dit : « Qui ça ? ». Il a répondu : « c’est un compositeur français »…Refus total des producteurs et obligation pour Anthony de choisir un autre compositeur. Mais Anthony peut être très obstiné et pour le Patient Anglais il a tenu bon…Avant de commencer véritablement à travailler sur la musique du film, on s’est amusé à faire des pubs pour apprendre à se connaître, notamment pour le premier téléphone portable (en 1994). Il a eu quand même eu beaucoup de mal à me faire accepter par son producteur : à l’époque je n’étais pas du tout connu aux Etats Unis. Je me souviendrais toujours de ce studio à San Francisco, avant que le film ne soit terminé, où j’ai joué la musique au piano et où j’ai conquis le producteur. La musique du PATIENT ANGLAIS a été composée pendant le tournage, je ne savais pas trop ce qui se passait à l’image : Anthony m’avait donné quelques indications, quelques références à Puccini pour m’inspirer, pour le côté élégant des mélodies et des harmonies, des références à Bach et aux musiques orientales. Quand je suis arrivé à San Francisco avec mon thème, composé alors sans aucune image, j’ai senti que j’avais touché juste. Souvent, écrire de la musique c’est un mouvement d’amour : on offre le fruit de son travail et de ses recherches. Là où j’ai le plus souffert dans ma collaboration avec Minghella c’est dans LE PATIENT ANGLAIS, quand il a fallu remplacer l’aria des Variations Goldberg de Bach. Le producteur voulait garder Bach, mais Anthony voulait ma musique. J’ai donc écrit ce thème au piano qu’on entend dans le film, inspiré de Bach. C’est ce qui m’a coûté le plus : remplacer Bach !...

Pour MONSIEUR RIPLEY, c’était une autre ambiance : il fallait une musique de thriller. Et ça m’a pris un temps fou aussi ! J’ai travaillé à partir d’un petit motif syncopé, qui m’est venu quand Anthony m’a parlé du personnage de Matt Damon, Monsieur Ripley. Il m’a dit : « c’est quelqu’un dont on peut dire qu’il est complètement scindé en deux : il avance d’un pied tandis que l’autre recule ». J’ai trouvé que l’expression musicale de cet état psychologique était parfaitement illustré par ce motif syncopé. Encore une fois, ce thème extrêmement simple (une gamme , encore une , descendante) est exploré puis décliné. Il y a aussi une chanson dans le film, chantée par Sinead O’Connor, mais ce n’est pas une chanson de fin, au contraire c’est une chanson qui débute le film, dont les paroles ont un vrai sens psychologique, qui introduisent toute l’atmosphère du film. MONSIEUR RIPLEY était une expérience très intéressante, avec des thèmes et des orchestrations qui me plaisent, encore aujourd’hui.

Avec COLD MOUNTAIN, on aborde encore autre chose : la guerre de sécession américaine. C’était une expérience moins intéressante parce qu’Anthony était moins présent, il voyageait partout pour le tournage. Le film était très imposant, probablement un peu trop, et j’ai eu du mal à y trouver ma place. Mais je pense en définitive que la musique la plus intéressante pour COLD MOUNTAIN est celle écrite avant le tournage, notamment pour cette scène où Nicole Kidman joue du piano sur une charrette. J’ai passé trois jours chez Anthony, devant qui j’ai joué mon thème sans pudeur, parce que je sais qu’on se comprend, puis je suis allé à Los Angeles pour rencontrer Nicole Kidman - qui, entre nous, est une femme exceptionnelle, très humble et très professionnelle. On a travaillé ce morceau pour que ce soit elle qui le joue dans la scène sur la charrette, ainsi qu’un morceau qu’elle joue avant la mort de son père.

Pouvez-vous nous dire quelques mots au sujet de BREAKING & ENTERING ?
C’est un film urbain, tourné à Londres. Psychologique mais aussi beaucoup plus léger que les précédents films d’Anthony Minghella, plus « pop ». J’ai écrit la musique en collaboration avec un groupe anglais, UNDERWORLD. Nous avons tellement bien travaillé ensemble que nous avons même des projets communs après ce film (une tournée au Japon notamment). Ça s’est très bien passé entre nous. NDRL : voir notre entretien d'octobre 2006 sur cette musique.

En 2004 vous abordez un genre nouveau avec TROY, malheureusement rejeté par la production. On a pu entendre quelques extraits de votre musique sur votre site internet…
J’avais effectivement mis des extraits sur mon site jusqu’au moment où j’ai été sommé par les producteurs de les retirer sous peine de payer de lourds dommages et intérêts : j’ai donc été obligé d’enlever ces extraits. Mais entre temps, vous avez peut-être eu l’occasion d’entendre cette musique…
Superbe musique, d’ailleurs…
Est-ce que justement vous trouvez que ça sonne comme LE PATIENT ANGLAIS ? C’était l’occasion ou jamais pour moi de montrer que j’avais envie et pouvais faire bien d’autres choses…
Vous avez écrit une fugue dans ce score rejeté (« The Sacking of Troy ») : c’est extrêmement rare en musique de film, surtout à Hollywood !
Il s’agit d’une fugue pour le personnage de Priam (Peter O’Toole). Dans LA CHUTE DE L’EMPIRE ROMAIN de Dimitri Tiomkin, il y avait aussi une fugue ! Mais pourquoi ici ? Parce que je trouve que quand il y a une telle dignité, comme il y avait dans l’attitude de Priam pendant la destruction de sa ville, je ne pouvais évoquer cette dignité qu’avec une forme musicale « digne ». Et qu’il y a-t-il de plus digne et élevé que la fugue ? Ceci dit, ce n’était pas ma première expérience j’avais déjà écrit une fugue dans LA LUNE DANS LE CANIVEAU, une autre dans HANNA K, dans BEYOND THERAPY de Robert Altman, et même une petite exposition de fugue dans WANG-FO de René Laloux. J’utilise la fugue quand je veux exprimer quelque chose d’élevé. Comme je suis autodidacte, je n’utilise pas la fugue pour prouver que je sais écrire, mais pour prouver mon attachement à la forme, à la beauté. La fugue est la plus belle forme de la musique.
En combien de temps avez-vous composé cette fugue dans le morceau « The Sacking of Troy » ?
Beaucoup de temps. J’ai passé un an à écrire la musique de TROY. J’ai dû prendre au moins quinze ou vingt jours pour composer cette fugue. Je ne m’en souviens plus très bien.
Quel regard portez-vous sur cette malheureuse expérience aujourd’hui ?
Vous savez, tout ce qui est arrivé devait arriver… Ce n’est pas parce que mon score était magnifique qu’il a été rejeté, c’est probablement à cause de beaucoup d’autres raisons plus complexes. Le rejet a été tellement stupide (en une nuit a été balayé un an de travail), qu’au début j’étais complètement terrassé. Mettez-vous à ma place ! Il m’était déjà arrivé d’avoir des scores rejetés avant TROY, notamment pour LES MISÉRABLES de Bille August (Musique finale de Basil Poledouris), mais ça ne m’a pas offensé. J’étais avec le réalisateur, avec les producteurs, avec des représentants de la Warner en Angleterre, qui écoutaient mon score et qui criaient au génie. Et tout d’un coup, le film s’en va aux Etats-Unis pour une projection test (alors qu’il n’était même pas fini), et en une nuit on me dit : « pardon, on va prendre quelqu’un d’autre »... Je n’ai pas vu le film avec la musique de James Horner, qui a certainement accompli des miracles en si peu de temps. Moi j’avais trois orchestrateurs sur TROY, James en avait pris cinq, ainsi que des assistants synthé, le même groupe Bulgare et la même soliste que j’avais utilisés pour ma partition. Je pense rarement au film qui vient après celui sur lequel je travaille. J’ai fait 70 films depuis 1979, c’est déjà beaucoup ! Je pourrais faire cinq films par an, parce que je compose très rapidement, mais il y a quelque chose en moi qui me dit « tu n’as pas le droit ». Finalement, j’ai choisi une solution de difficulté : je passe du temps sur un film, mais je donne à ce film l’essence de ce que je suis. Chaque note que j’écris, je l’écris en toute conscience et après une longue recherche.
Quel est votre rapport avec le cinéma français d'aujourd'hui, sachant que certains de vos collègues comme Philippe Sarde ou Pierre Jansen le désertent de plus en plus, voire complètement ?
Et bien moi je revient en France et j’ai envie de travailler avec le cinéma français ! De toute façon le cinéma français n’est plus complètement français : beaucoup de films sont des co-productions européennes ou américaines. Mais le cinéma français est bien vivant. Je comprends ce que dit Philippe Sarde, Sautet est mort, ses amis sont partis, il y a beaucoup de changement dans la nouvelle génération, mais ça ne veut pas dire que c’est du n’importe quoi ! Ce qui me gêne en revanche c’est la course cynique aux entrées (notamment avec toutes ces comédies qui se suivent et se ressemblent un peu) qui fait qu’on néglige un travail de mise en scène, c’est une simple course à l’argent. Mais je suis certain qu’il y a des valeurs dans le cinéma français, comme partout ailleurs. Cette nouvelle génération est plus éclairée, plus folle, elle a beaucoup plus les moyens de découvrir le monde (grâce à internet), plus de fantaisie… Si des jeunes réalisateurs viennent vers moi et me demandent de travailler avec eux, j’en serais ravi. Moi je cherche une rencontre, quelqu’un d’une certaine rigueur mais avec aussi une part de fantaisie. Au niveau de la création, l’Europe reste très présente. Après tout, le cinéma américain des grandes années c’est un cinéma d’européens fraîchement émigrés aux USA…
Je comprends aussi Pierre Jansen, qui a écrit des partitions exceptionnelles en terme de qualité et d’intelligence pour le cinéma et d’autres œuvres exceptionnelles pour le concert. Je précise que c’est un ami, même s’il me reproche souvent de ne faire que de la musique de film et pas autre chose… Mais ce que je donne en musique de film c’est l’essence de ce que je suis. Je n’ai pas de jardin secret que je réserve au concert.
Hans Zimmer avait dit dans une interview que sa partition préférée pour un film sorti en 1996 était LE PATIENT ANGLAIS, qui faisait partie selon lui des 10 % à retenir parmi tout ce qui se fait en musique de film à Hollywood. Avez-vous également un regard sur vos collègues ?
Personnellement je n’écoute pas beaucoup de musique de film, mais dès que j’entends quelque chose qui plane au-dessus du reste, je prends mon téléphone et j’appelle le compositeur, je crée une rencontre. Pour prendre un exemple, en dehors de Bruno Coulais qui est un ami pour qui j’ai beaucoup de tendresse et de respect, j’ai récemment adoré la musique dans un film d’Almodovar. « Qui a fait ça ? » Alberto Iglesias. J’ai appelé mon agent, qui m’a donné ses coordonnées, et je lui ai envoyé un e-mail qui disait : « J’aime ce que tu fais ». On s’est rencontrés à Berlin, puis on s’est revus à Londres. Avec certaines personnes c’est comme entre frères, on se reconnaît, on sait ceux qui cherchent, ceux qui aiment la musique. Récemment, c’est l’un des seuls dont j’ai entendu les œuvres : j’ai acheté ses disques, je lui ai envoyé les miens, on s’écrit, on se parle… Je n’aime cette idée répandue que la musique de film est une musique « inférieure », je suis plutôt idéaliste, de ceux qui pensent que même au cinéma on peut apporter la beauté et la perfection dans l’ouvrage.. Iglesias, Coulais, Desplat, Mechaly, Morin, Rombi, bien des compositeurs qui contribuent à donner à la musique de film ses lettres de noblesse. Vous savez je vote pour les Oscar, pour les British Awards et pour les César : on m’envoie tous les disques des nominés. J’ai parfois l’impression d’entendre toujours la même musique, à quelques exceptions près : Elliot Goldenthal, qui a fait des partitions très intéressantes, Benoît Charest que j’ai croisé aux Oscars (pour la chanson des TRIPLETTES DE BELLEVILLE) et que j’ai revu récemment à Londres entre autres…
Avez-vous des projets de concert ? Pourriez-vous par exemple adapter votre musique rejetée pour TROY sous la forme d’une symphonie ou d’un opéra, à défaut d’éditer en CD les sessions d’orchestre ?
Non, parce que c’est une musique qui ne m’appartient pas. Je dois oublier ça. Ça n’intéresse que les amateurs qui veulent se souvenir que j’ai travaillé sur ce film, mais oublions cela. Moi je l’ai déjà oublié. De toute façon je n’ai plus aucun droit sur TROY, puisque le studio est resté propriétaire de la musique. Mais j’ai envie de donner des concerts, de former un groupe de huit à dix musiciens qui accepteraient de tourner avec moi. Je suis aussi un rythmicien, j’aime la fantaisie, l’improvisation. J’aimerais écrire chaque jour de nouvelles musiques que je pourrais expérimenter en public dans le cadre d’une tournée. Encore à mon âge (57 ans), j’ai toujours faim de musique, je suis « possédé » par la musique, le cinéma ne me suffit pas pour exprimer toute la musique
Eric Serra justement a renoué avec ça récemment, puisqu’il va tourner avec son groupe de jazz-rock… La scène lui manquait.
La scène m’intéresse aussi, ce que je voudrais c’est travailler avec des musiciens tous les jours et expérimenter de nouvelles choses. J’ai besoin du contact direct car dans notre métier nous sommes souvent un peu isolés et seuls. Ce serait un projet dans lequel je m’investirais complètement, de la même manière que je m’investis dans tout ce que je fais.
Après de nombreuse partitions pour des films anglo-saxons, on vous a retrouvé en France en 2005 avec L’AVION de Cédric Khan, une partition aérienne qui renoue un peu avec le style de vos débuts en France : est-ce un début de « retour aux sources » ?
Oui, une partition simple, thématique, qui « plane » au-dessus des événements du film. J’ai beaucoup aimé ma rencontre avec Cédric Kahn. Il ne voulait pas de compositeur au départ. Mais quand il a entendu mes musiques, il a bien voulu me rencontrer. Quand on s’est rencontrés, je lui ai dit que je voulais travailler parallèlement à l’image, pas après. Il a accepté. Trois mois après, il est venu à Londres et je lui ai fait écouter mes premiers essais, tandis que lui de son côté avait apporté des images du film. On a posé la musique sur les images et là, miracle ! Ce que j’avais fais en pensant au film (mais sans avoir vu les images), finalement se mariait miraculeusement au film. Ce fut une expérience formidable et je regrette vraiment que le film n’ait pas marché. Tout ça pour un problème de sortie, ça n’a rien à voir avec la valeur du film. Ce film est touchant, étrange, très bien réalisé et je pense qu’on le redécouvrira un jour…
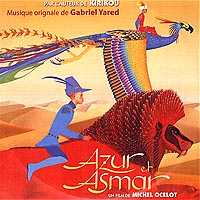
Avec AZUR & ASMAR de Michel Ocelot vous retrouvez un grand cinéaste d'animation français (après René Laloux dans les années 80). Quand avez-vous commencé à travailler sur ce film ?
J'ai commencé à travaillé sur AZUR & ASMAR en 2004, car Michel avait besoin de mes maquettes pour animer. J’ai commencé par écrire la berceuse, avant même que le travail d’animation soit entamé. C’est cette berceuse qui ouvre le film. Ensuite, j’ai envoyé au fur et à mesure des maquettes pour la phase d’animation.
Michel Ocelot semble être un réalisateur exigeant, comme l’était René Laloux…
En matière de dessin, d’image, de dialogues, de décors… il est effectivement très exigeant. On a une entente extraordinaire, mais il découvre l’impact de la musique avec AZUR ET ASMAR, il n’avait jamais eu ce genre d’expérience sur KIRIKOU ou ses films précédents. Ici, il dit que ma musique éclaire l’image, et qu’elle a une telle autorité qu’il en a parfois peur ! Ce qui me plaît beaucoup dans ce film, c’est le retour à l’Orient, car le film se passe aux deux tiers dans le Maghreb (et pour un tiers dans l’Europe du moyen âge). Le score est donc un mélange de musique orientale et d’orchestre symphonique. C’est une sorte de retour à HANNA K, mais avec un autre challenge, puisque les personnages chantent et dansent, la musique doit être synchro avec l’animation… Mais je persiste à dire qu’une musique de film peut-être forte tout en étant synchro, qu’elle peut être construite pour elle-même tout en servant le film. J’ai passé beaucoup de temps sur ce film (un an et demi déjà !), mais je pense que nous allons arriver à une couleur musicale extraordinaire. Je n’ai jamais vu des images aussi belles de ma vie. Bien sûr j’ai vu des films de Miyazaki, mais là vous allez être subjugué, au point de vouloir arrêter l’image en pleine projection pour la contempler ! Les décors ont été réalisé d’une main de maître : imaginez tous les détails d’ornement dans les palais orientaux… Je suis fou de joie d’avoir participé à ce projet. Je lui souhaite au moins le succès de KIRIKOU, sinon plus. C’est un sujet très ambitieux et qui traite du respect à la différence .
Vous parlez d’un retour à la musique orientale avec AZUR & ASMAR : concrètement, quel a été le choix des instruments et plus généralement de la couleur musicale du film ?
Ce n’est pas spécialement un retour à la musique orientale : le sujet même du film est le respect de la différence, un aperçu des relations entre l’orient et l’occident. Dans AZUR & ASMAR, Azur vient d’un certain occident, et Asmar d’un certain orient, au sens large. Pour résumer, c’était une excellent occasion de pratiquer à nouveau un mélange entre musique orientale et occidentale, comme je l’avais fait dans HANNA K ou ADIEU BONAPARTE. Mais il n’y a pas que des instruments orientaux, il y a aussi des instruments anciens : pour la première partie qui se déroule dans un château pendant la période médiévale, j’ai utilisé des flûtes à bec, des diapasons, et un positif (clavier d’orgue qui pourrait parfois sonner un peu comme un orgue de barbarie). Plus on avance dans le film, plus les instruments orientaux viennent s’ajouter : d’abord, une petite formation, puis enfin l’orchestre symphonique qui développe la troisième partie du film. Les instruments orientaux que j’ai utilisés sont essentiellement le kanoun (un instrument à cordes qu’on joue avec des onglets), qui ressemble un peu à la cithare autrichienne qu’on peut entendre dans LE TROISIEME HOMME. Il y a aussi un oud (une sorte de luth), un naï (une flûte en roseau qu’on joue un peu de travers, qui a un son magnifique, très chaleureux), un violon arabe, et des percussions orientales.
Aviez-vous déjà utilisé ces instruments dans vos précédentes partitions ?
J’avais utilisé les mêmes instruments dans HANNA K, mais ils étaient alors mélangés à un orchestre symphonique. Ici, ils jouent plutôt « entre eux », je m’en sers rarement à l’intérieur de l’orchestre, sauf pour les scènes de chevauchées et les poursuites, où ils se mêlent à l’orchestre symphonique pour donner une couleur.
Avec quel orchestre avez-vous enregistré la musique d’AZUR & ASMAR ?
La partie symphonique a été enregistrée avec l’Orchestre de l’Opéra de Lyon, et les petites formations (30 à 35 musiciens) ont été enregistrées à Londres, à Abbey Road, parmi lesquels se trouvent quelques bois de l’époque médiévale. J’ai aussi utilisé l’échantillonneur pour donner un peu plus de soutien aux percussions, ainsi que des chœurs, enregistrés à Londres : un chœur d’enfants, et un choeur mixte (soprane / alto / ténor / basse).
Y a-t-il des chansons dans le film ?
Il y en a une, mais elle n’est pas à la fin en « End Credits », c’est une berceuse qui est à la base même du film, chantée par le personnage de la nourrice au début du film. Cette berceuse est reprise quatre ou cinq fois dans le film et se termine naturellement par une chanson interprétée par Souad Massi, une formidable chanteuse algérienne très connue en Europe, qui a écrit le texte de la chanson avec Michel Ocelot.
Et vous en avez composé la musique ?
Oui, on a travaillé une partie de cette chanson à Londres, et une autre partie à Paris, au studio Ferber. Pour résumer les phases d’enregistrement, il y a eu d’abord l’Orchestre de l’Opéra de Lyon enregistré en studio mobile par mon ami et collaborateur –génial- de longue date René Ameline, l’ingénieur en chef du studio Ferber à Paris, qui a aussi fait les prises des musiciens orientaux en studio et l’enregistrement de la chanson, tandis que tout le reste a été fait à Londres avec Peter Cobbin, ingénieur en chef des studios Abbey Road (il a mixé la musique du SEIGNEUR DES ANNEAUX).
Est-ce que le fait d’être né au Liban a une résonance particulière pour vous par rapport à ce film qui parle de la relation entre l’orient et l’occident ?
Non seulement ce film me touche beaucoup mais je me reconnais parfaitement dans cette histoire, je suis moi-même Azur et Asmar à la fois ! Je suis un produit de l’orient et de l’occident. Je crois que le fait que Michel Ocelot m’ait choisi tient beaucoup à cela : à la fois ma culture personnelle et ma culture musicale, qui vient de ces deux endroits.
Michel Ocelot a-t-il manifesté l’envie de retravailler avec vous à l’avenir ?
Je n’essaye pas d’accrocher les réalisateurs en leur disant : « il faudra qu’on retravaille ensemble », mais je sais que l’amitié qui est née de notre collaboration est une amitié qui durera. Mais cette amitié ne se manifestera pas forcément avec une collaboration permanente. Parmi mes amis, je peux compter sur Jean-Jacques Annaud qui a travaillé avec moi, et qui en ce moment travaille avec Alberto Iglesias, il a travaillé aussi avec John Williams, James Horner… N’empêche que Jean-Jacques est mon ami et que nous nous retrouverons sur d’autres projets. La fidélisation entre Anthony Minghella et moi-même vient de bien d’autres facteurs.

Avec BREAKING & ENTERING qui scelle votre quatrième collaboration avec Anthony Minghella, vous signez une musique de film avec quelqu’un d’autre, ici en l’occurrence le groupe anglais UNDERWORLD...
Depuis deux ans, je ne fais rien d’autre que ces deux films : AZUR & ASMAR pour lequel j’ai commencé à écrire en 2004, avant la phase d’animation, et BREAKING & ENTERING, qui m’a pris également près d’un an et demi de travail, en collaboration avec le groupe UNDERWORLD. On a commencé en avril 2005 pour terminer à la fin de l’été 2006.
On ne s’attend pas à entendre le compositeur du PATIENT ANGLAIS avec un groupe d’électro ! Là encore, il s’agit d’une volonté de balayer le passé, d’évoluer ?
Oui, BREAKING & ENTERING est une partition très rythmique, légère, où les cordes de l’orchestre ne sont utilisées que comme couleur pour soutenir l’électronique et les parties acoustiques, jouées par Karl, Rick (du groupe UNDERWORLD) et moi-même. On se retrouvait ensemble en studio et on jouait un peu de tous les instruments en partant de presque rien, seulement quelques thèmes. Il m’est arrivé de jouer des percussions et de l’accordéon, eux jouaient du clavier, des guitares, du cajon, des percussions, chantaient etc… C’était une extraordinaire entreprise de recherche, mais finalement aussi d’harmonie entre eux et moi, qu’on entend d’ailleurs parfaitement sur le film.
Qu’est-ce qui vous a inspiré sur ce film ? Le contexte urbain, les acteurs, l’histoire ?
Le contexte urbain, oui. Pour ce qui est de l’histoire, il faut savoir qu’Anthony Minghella n’écrit pas de scénarios originaux en général. Il avait écrit le scénario son premier film, TRULY MADLY DEEPLY, mais après cela il n’a fait que des adaptations de livres très connus comme LE PATIENT ANGLAIS, MONSIEUR RIPLEY ou COLD MOUNTAIN. Mais dans BREAKING & ENTERING, il est revenu à une écriture personnelle, puisqu’il signe lui-même le scénario. Il avait envie autant que moi de changement, d’alléger sur le plan musical, de rythmer, d’être plus urbain. La musique ressemble à cela. A l’entendre, c’est pour moi un produit très nouveau : cette association avec UNDERWORLD m’a ramené à mes anciennes amours (écrire des rythmiques, faire des boucles), ce qui n’empêche pas la présence de thèmes.
C’est donc autant une évolution dans l’œuvre de Minghella que dans la vôtre…
Oui, enfin chez moi c’est plutôt un retour aux sources, tandis que pour Anthony c’est surtout l’envie d’autre chose que de l’orchestre, une envie de musique plus simple.
Pourquoi avoir choisir UNDERWORLD pour ce film ?
Anthony a rencontré pas mal de groupes, mais le choix d’UNDERWORLD s’est surtout fait sur le plan humain : ici, on avait affaire à un groupe de deux personnes très unies (ils sont ensemble depuis 30 ans). Le choix s’est davantage porté sur le fait qu’on s’est bien entendus tout de suite que sur un plan strictement musical.
Comment s’est effectué ce choix d’une musique orchestrale et électronique ?
La musique électronique est très intéressante mais comporte un son « inhumain », assez loin de l’émotion. A la base, la musique techno d’UNDERWORLD est plutôt destinée à la danse. Là, il s’agissait de faire danser les images ! Mais on ne pouvait pas faire une musique trop rythmique : c’est une musique toujours suspendue, toujours en attente, et pourtant elle exprime beaucoup les émotions des personnages. Il y a en particulier un thème affecté à Jude Law et Juliette Binoche, une boucle harmonique avec au-dessus un violoncelle solo, qui est extrêmement émouvant.
Que retirez-vous de cette expérience ?
D’un film à l’autre, on essaie d’en tirer quelque chose, de savoir si on a avancé, si on est allé ailleurs que dans les chemins déjà parcourus. Et ce film représente un ailleurs pour moi, autant qu’il fut l’occasion de rencontrer ce groupe génial de gens qui sont devenus mes amis, avec qui peut-être un jour je donnerai un concert. Anthony Minghella a également un projet de film qui se déroule en Afrique, peut-être qu'alors je serai en mesure de collaborer avec des compositeurs et des musiciens africains.



Interview B.O : Pierre Desprats (Les Reines du drame, de Alexis Langlois)
Interview B.O : Audrey Ismaël (Diamant brut, de Agathe Riedinger)