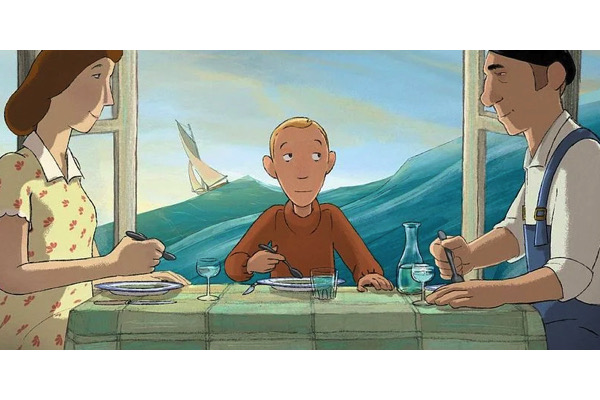
Propos recuellis par Benoit Basirico
dans le cadre du Festival d'animation d'Annecy
Pascal Le Pennec retrouve Jean-François Laguionie sur “Slocum et moi” (en salles le 29 janvier 2025), son nouveau film d'animation, après “Le tableau” (2011) et “Louise en hiver” (2016), à travers le récit d'un jeune garçon de 11 ans, François, qui raconte en voix off ses souvenirs auprès de ses parents, dans la France d'après-guerre, en feuilletant les dessins d'albums de famille, avec un père amateur de navigation qui veut construire le même bateau que le navigateur Joshua Slocum. La partition épouse ce récit nostalgique, ce regard émerveillé et tendre, oscillant entre le piano intime et le jazz manouche (accordéon, clarinette, contrebasse, guitare rythmique), prolongeant la musique des musiciens du Café La Marine. Une musique épique (cordes, flûtes, cuivres, harpe, percussions) accompagne un récit de voyage mouvementé, avec des pirates et des dangers en mer, lorsque l'adolescent lit le carnet de bord du navigateur, contrastant avec sa vie paisible (cela évoque alors le film "Le Tableau" lorsque la musique révélait les intrigues enfouies dans les œuvres), relatant un imaginaire romanesque et poétique. Voici les propos tenus par le compositeur et le réalisateur lors d’une table ronde modérée par Benoit Basirico (Cinezik) au Festival d’Annecy en juin 2025, à l’initiative de la SACEM.
 Cinezik : Jean-François Laguionie, vous avez dit : "Presque tous mes films sont des films musicaux", qu'est-ce que vous entendez par là ?
Cinezik : Jean-François Laguionie, vous avez dit : "Presque tous mes films sont des films musicaux", qu'est-ce que vous entendez par là ?
Jean-François Laguionie : La musique est essentielle pour moi. Quand j'ai l'idée d'un film, ce ne sont pas seulement des dessins, c'est avant tout du cinéma. Mon premier film, "La Demoiselle et le violoncelliste", m'a été inspiré par un concerto pour violoncelle de David Popper. J'ai donc écrit l'histoire d'abord sur un concerto, en écoutant un vieux 78 tours, que j'ai utilisé pour le film, ce qui a posé des problèmes techniques au niveau de la diffusion. Et c'est là que j'ai commencé à me rendre compte que je parlais de la même façon avec le musicien qu'avec le décorateur du film. Le langage était à peu près le même.
Pascal Le Pennec, d'abord instrumentiste, accompagnateur, compositeur, orchestrateur dans les domaines du concert, du théâtre et de la chanson, pourquoi vous êtes-vous dit en 2005 que le cinéma serait votre territoire de prédilection ?
Pascal Le Pennec : Il me semblait important en effet de quitter la scène. L'écriture musicale a toujours occupé une place importante dans ma vie de musicien et dans ma vie tout court. Je ne dirais pas que j'avais fait le tour de la question sur scène, ce serait faux, on n'a jamais fini. En tout cas, la scène a occupé une telle place dans ma vie que j'ai ressenti le besoin très fort de cesser totalement d'exercer mon métier sur scène et de passer à la composition. Après quelques courts métrages, j'ai eu la chance incroyable de faire la rencontre de Jean-François qui m'a appelé pour "Le Tableau". Et les choses se sont ensuite enchaînées sur le terrain du cinéma, d'une façon assez singulière. C'est-à-dire que la vie a présenté les choses d'une façon assez singulière. J'ai toujours été passionné de cinéma, mais en rencontrant Jean-François, les choses se sont enchaînées sur le terrain du cinéma d'animation. Et je réalise maintenant la chance extraordinaire pour le compositeur que je suis de travailler particulièrement dans le domaine de l'animation.
Quel est généralement le point de départ du processus créatif pour vos films ?
Jean-François Laguionie : Je fais ce que j'appelle une animatique sauvage du projet. C'est-à-dire que très rapidement, avant même que le producteur soit présent sur le film, je veux savoir à peu près où il faut aller. J'ai eu une expérience un peu malheureuse dans le passé avec un film à gros budget, avec des producteurs européens, une grosse machine industrielle. Je sortais de films personnels, que je fais pratiquement seul, en toute petite équipe. Je me suis fait engloutir dans les rouages de cette machine. Il fallait absolument que je retrouve une façon personnelle de créer un film, comme si je faisais une peinture ou écrivais un roman. C'est là que j'ai commencé à penser, dans les années 90, avec "Le Château des singes", à faire cette animatique, une sorte de roman du film qui devait être à la fois sonore et graphique, qui regroupe tous les niveaux de la création d'un film. Ensuite, je l'ai faite de façon plus précise avec les films suivants. Cela m'a permis de rencontrer Pascal et de l'inclure dans ce processus. Cela me paraît maintenant tellement naturel que je ne suis plus capable de faire un film sans passer par lui.
Pour "Le Tableau", des musiques préexistantes figuraient sur les animatiques ?
Pascal Le Pennec : Sur "Le Tableau", je suis intervenu une fois le film terminé. Et je me souviens du délai qui m'a été donné : trois mois pour composer, orchestrer et enregistrer une musique de 45 à 50 minutes, retenue sur le film, en grande partie symphonique. Durant ces trois mois, il fallait également réaliser des maquettes sur échantillonneurs afin que les idées soient validées par Jean-François. C'est un cas de figure assez classique pour les compositeurs. Par chance, Jean-François avait posé des musiques provisoires. Et je dis par chance - je sais que cela peut créer une polémique, de nombreux compositeurs étant opposés au principe des musiques provisoires - car personnellement, dans ce cas précis, il y avait si peu de temps que les musiques provisoires - évidemment, il ne s'agissait pas de les copier - remplaçaient bien les discours. Je ne suis pas totalement opposé à ce principe. Cela donne la possibilité de percevoir l'intention, ce que souhaite le réalisateur, quel est son rêve de musique.
Jean-François Laguionie : C'est un guide, sans aller jusqu'à l'imitation.
Pascal Le Pennec : Surtout pas. Mais c'est une information capitale, pour moi. Il y avait aussi sur "Le Tableau" un document, un "chemin de fer", un document très précieux. Ses indications étaient précises. Il indiquait au compositeur ce qu'il convenait de composer comme musique et comme type de musique. La couleur orange renvoyait à ce que Jean-François appelait la "musique de film". Cela peut prêter à sourire, puisque l'ensemble est de la musique de film.
Qu'entendiez-vous par "la musique de film" ?
Jean-François Laguionie : C'est la musique qui soutient et accompagne l'action.
Pascal Le Pennec : Ce n'est pas ce que je préfère faire.
Jean-François Laguionie : Oui, ce n'est pas ce que tu préfères. Tu me le dis souvent, en effet. Il est vrai que, chez les compositeurs, la musique joue un rôle bien plus important que celui d'accompagner simplement l'action.
Pascal Le Pennec : Pour revenir au "chemin de fer" élaboré pour "Le Tableau", le vert, c'était le thème de la guerre. Les pointillés, c'était l'incertitude quant au fait qu'il y ait de la musique ou non sur cette séquence. En bleu, le thème de l'amour qui revient souvent dans le film, l'amour entre Rameau et Claire ; en violet, le thème du peintre ; en jaune, ce que tu appelais très justement les musiques locales. Je crois que dans un langage savant, on parle de musiques intra-diégétiques, des musiques qui appartiennent aux personnages, qu'ils entendent dans l'action. Et, en l'occurrence, il s'agissait de ce qui provient du château ou des rues du carnaval de Venise. Ce fut un document très important pour moi.
Et pour "Louise en hiver" ?
Pascal Le Pennec : C'était un cas de figure différent. Le film était loin d'être terminé, j'ai disposé de neuf mois. Par ailleurs, il y avait un deuxième compositeur qui a composé des thèmes de jazz au piano solo, Pierre Kellner, et j'ai composé pour ma part, à la demande de Jean-François, la musique pour orchestre et chœur. C'était appréciable d'être appelé en amont d'un projet.
Il y a eu là encore des musiques provisoires posées sur l'animatique ?
Pascal Le Pennec: Du Debussy, un de nos compositeurs préférés. Nous avons cette chose en commun, Jean-François et moi, cet amour immodéré pour cette tranche de l'histoire de la musique, la musique du début du XXe siècle, française, mais aussi russe. Et avoir cette référence... Évidemment, il ne s'agissait pas de copier ce que tu avais posé comme musique provisoire, mais cela a été une source d'inspiration importante, et j'ai quand même, sans la copier, je crois, essayé de m'approcher... Je me suis replongé dans cette musique que j'adore et j'ai essayé d'être dans l'esthétique de Debussy.
Hormis ces références musicales qui guident, y a-t-il aussi des références graphiques, des couleurs, qui peuvent guider la musique ?
Jean-François Laguionie: Non, la couleur n'est pas très importante dans cette étape du film. Par contre, savoir où poser la musique l'est. Je sens, en écoutant Pascal, si elle va être plutôt ici ou plutôt là. Parfois, avec des intuitions tout à fait primaires, par exemple, quand les personnages partent, quand il y a un départ, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai absolument envie de musique. Et sur le registre des sentiments, on se pose la question de savoir si la musique va être présente ou plutôt discrète.
Et Pascal Le Pennec, quand vous découvrez le graphisme de "Louise en hiver", très épuré, qui rappelle les peintres du début du XXe, est-ce que cela appelle une musique de cette période ?
Pascal Le Pennec: J'y faisais référence juste avant. Il y a un lien évident entre ce que j'ai découvert comme graphisme dès les premiers travaux de "Louise en hiver", dans les dessins préparatoires où Jean-François fait lui-même allusion à ces post-impressionnistes, comme des peintres de nuages. Et évidemment que cela m'a conforté dans l'idée de ce qu'il fallait comme musique et cette intuition très juste qu'avait eue Jean-François au travers de cette musique provisoire, d'aller musicalement vers une esthétique impressionniste.
Dans votre collaboration, même s'il y a ce souci du placement, nous sommes moins dans une synchronisation, dans un rapport strict à l'image, que dans l'installation d'une atmosphère et d'une humeur, n'est-ce pas ?
Pascal Le Pennec: Oui, c'est très vrai, particulièrement dans "Louise en hiver" et dans "Slocum". Peut-être un peu moins dans "Le Tableau" où il y a davantage de points de synchronisation. Mais c'est vrai que nous travaillons surtout sur des ambiances générales à créer.
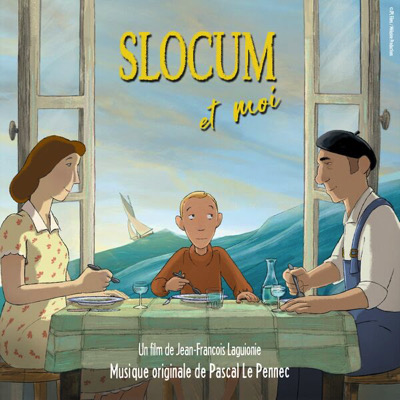 Abordons maintenant "Slocum et moi", qui marque une nouvelle évolution dans votre collaboration, puisqu'il s'agit d'un travail amorcé très en amont, sans animatique, sans chemin de fer, sans musique préparatoire. L'idée était-elle de se dire "là, on en termine avec la musique provisoire" et d'être devant une page blanche ?
Abordons maintenant "Slocum et moi", qui marque une nouvelle évolution dans votre collaboration, puisqu'il s'agit d'un travail amorcé très en amont, sans animatique, sans chemin de fer, sans musique préparatoire. L'idée était-elle de se dire "là, on en termine avec la musique provisoire" et d'être devant une page blanche ?
Pascal Le Pennec: Sur "Slocum", j'ai pu voir des premiers dessins préparatoires et des textes, mais en effet, pas d'animatique, pas de musique provisoire ni de scénario, juste quelques conversations sur ces histoires croisées, celle de Slocum, de la famille, du chantier. Vous vouliez m'en dire le moins possible avec Anik Le Ray, la co-scénariste, juste quelques bribes de conversations. En fait, tout existait, le scénario, l'animatique, etc. Mais vous ne vouliez pas me les montrer. Je me suis senti comme un enfant privé de ce qu'il voulait absolument obtenir et qu'il n'avait pas moyen d'avoir. Donc, quelques conversations. J'ai quand même eu quelques éléments d'histoire, j'ai pu imaginer des séquences. Et il y a eu des dessins et des lectures. Cela m'a impressionné. Tu m'as conseillé des lectures, des épopées homériques, notamment l'autobiographie de Slocum, qui est incroyable, et puis des dessins préparatoires.
Jean-François Laguionie: Ce sont des croquis rapides.
Pascal Le Pennec: Le magnifique dessin de décor de la maison familiale a vraiment nourri mon imagination. Il fallait pour ce film camper deux univers : les bords de Marne, où a vécu Jean-François dans son enfance, et Slocum à la fin du XIXe siècle, sur mer. Il y a donc à la fois une musique avec une certaine ampleur romanesque pour illustrer ce navigateur, et une musique plus jazz manouche pour les bords de Marne.
Quand vous voyez ces images-là, cela appelle l'orchestre ?
Pascal Le Pennec: Très tôt, nous nous sommes entendus sur le fait que tout ce qui concernait Slocum sur son bateau serait traité par l'orchestre. Mais tu m'as dit que l'orchestre et le thème de Slocum devaient aussi intervenir sur les scènes parisiennes, car tu as vécu, avec tes parents, dans ce jardin familial, et c'était aussi une vraie épopée. Ainsi, la musique symphonique du thème de Slocum est aussi appliquée aux scènes parisiennes. Cela se produit dans tous les films de Jean-François Laguionie : c'est l'interpénétration des univers.
Jean-François Laguionie: En fait, le film raconte deux voyages : un voyage immobile et un vrai voyage. Il fallait qu'il y ait l'interpénétration des deux par la musique, mais pas seulement par la musique, aussi par des éléments météorologiques.
Pascal Le Pennec: Ah oui, très rapidement, tu m'as parlé de l'état de la météo : la tempête, le grand soleil, le calme plat. J'ai compris rapidement que tu voulais parler aussi de la météo psychologique, qu'elle renvoyait à l'état d'âme, aux états psychologiques dans lesquels étaient les personnages, à la fois sur mer et sur le chantier, confrontés à des situations heureuses, malheureuses, difficiles, catastrophiques.
On voit quand deux artistes qui ne sont pas forcément dans le même territoire peuvent se comprendre, trouver un langage commun. Et donc là, vous parliez de météo, c'est une manière de vous retrouver ensemble et de déclencher une inspiration musicale ?
Pascal Le Pennec: C'est vrai que sur les films précédents, "Le Tableau" et "Louise en hiver", nous avions découvert assez vite que nous pouvions nous exprimer en termes de couleurs. Pour la Forêt maudite dans "Le Tableau", tu m'avais parlé du vert sombre. Mais dans ce nouveau film, cela s'est passé d'une manière tout à fait différente. Puisque tu ne pouvais pas me parler de l'histoire, c'est bien simple, il me dit "tu composes de la musique, tu me proposes des thèmes, et voilà..." J'ai composé 45 minutes, à peu près, et j'ai fait des maquettes.
Expliquez ce stade de la maquette. S'agissait-il de faire des musiques sur ordinateur avec de faux instruments ?
Pascal Le Pennec: Ce ne sont pas forcément de faux instruments. J'enregistre aussi de manière authentique des parties auprès des instrumentistes. Mais je me sers de l'informatique dans cette étape du travail, quand il s'agit de musique d'orchestre, pour obtenir la validation du réalisateur. J'utilise à ce moment-là des échantillonneurs, par exemple une librairie de sons très connue, Vienna Symphonic Library.
Vous avez d'ailleurs fait intervenir un violoncelliste pour la maquette ?
Pascal Le Pennec : Oui, autant j'ai remarqué que les machines, ces synthétiseurs-échantillonneurs, sont un atout pour faire entendre ses idées, mais il y a quand même quelque chose d'artificiel. Alors, ce que j'aime faire au stade de la maquette, c'est de faire venir des instrumentistes pour mettre un peu de vie là-dedans. Je fais donc venir un violoncelliste, un de mes enfants d'ailleurs, pour donner un peu de vie à ces maquettes avant que nous passions à l'enregistrement, proprement dit, avec un orchestre véritable. Sinon, cela se passe de manière tout à fait traditionnelle : papier, crayon. Je me fabrique mon film, avant le film, et j'ai livré ainsi à Jean-François à peu près 45 minutes de thèmes, dans lesquelles il s'est servi.
Vous avez besoin de contraintes pour composer ?
Pascal Le Pennec: J'ai besoin d'images dans ma tête. Nous avons cela en commun de manière inversée, Jean-François et moi. Tu as besoin de musique pour créer des histoires, des personnages, des situations, et moi j'ai toujours eu besoin, pas seulement pour la musique de film, d'images mentales pour composer.
Et sur "Slocum" où vous étiez présent très en amont, vous avez donc donné des thèmes à Jean-François Laguionie qui a fait son animatique en fonction de la musique ?
Pascal Le Pennec: C'est quand même un projet qui a pris quelques années, et heureusement, je pense, que nous avons eu la chance d'avoir autant de temps. L'animatique a progressé elle-même et a nécessité des retouches musicales. Parfois, il y avait des trous qu'il fallait combler.
Jean-François Laguionie: La production était très difficile à monter. Cela s'est étalé sur des années, nous voyions les années passer, et rien ne se précisait sur le plan financier, c'était assez dramatique. Alors évidemment, nous n'avions pas à nous tourner les pouces pendant ce temps-là, j'avais tellement envie de faire ce film. Les dessins changeaient constamment, donc Pascal se retrouvait avec des dessins différents d'un moment à l'autre.
Pascal Le Pennec: J'ai eu des surprises de taille. En fait, en composant en amont, j'avais composé sur un film imaginaire que je m'étais créé. Et ensuite, quand il m'a enfin autorisé à travailler sur l'animatique, je me suis rendu compte que vous aviez appliqué des thèmes que j'avais imaginés pour certaines situations à d'autres moments. C'était assez troublant.
Concernant les différentes palettes musicales (l'orchestre, le romanesque, le jazz manouche, la musette...), on oscille d'un registre à l'autre. Vous vous revendiquez comme un compositeur caméléon ?
Pascal Le Pennec : Oui, c'est quelque chose qui me plaît infiniment dans ce métier, dans cette tâche de compositeur appliqué au cinéma. Je pense souvent à des amis qui travaillent dans le monde de la musique contemporaine, qui passent leur vie à élaborer leur propre langage musical. Et nous, dans le cinéma, nous avons cette chance de pouvoir nous adapter à des demandes extrêmement diverses. J'ai remarqué d'ailleurs qu'il y a une tendance à allonger la liste des musiques additionnelles. C'est-à-dire qu'on engage un autre compositeur ou qu'on a recours à des musiques préexistantes pour les besoins plus accessoires. Mais j'aime beaucoup dans ce métier passer d'un style à l'autre, des styles aussi différents que l'univers symphonique concertant pour le grand orchestre, et le jazz manouche ou une fanfare municipale.
Malgré cette polyvalence et le fait d'avoir plusieurs registres, le fait que ce soit quand même le même compositeur pour tout, il y a une certaine unité. On arrive à vous retrouver, on reconnaît Pascal Le Pennec...
Pascal Le Pennec : Je suis touché. J'ai l'impression, même si on me donne à toucher des choses extrêmement différentes, de toujours laisser quelque chose de moi-même, de laisser quelque chose de sensible au-delà du langage employé.
Terminons le processus de travail avec "Slocum". Nous avions parlé de ces ajustements musicaux suite aux animatiques. Ensuite, de nouvelles musiques ont été ajoutées. Et pour celles-ci, en revanche, des références sont intervenues ?
Pascal Le Pennec : J'ai donc livré des thèmes, Jean-François Laguionie a choisi les thèmes qui l'intéressaient. Et après, des demandes particulières sont intervenues de sa part pour des besoins précis. Et là, cela s'apparente au travail plus conventionnel de la musique de film, soit répondre à des demandes précises d'un réalisateur. En l'occurrence, je pense à la scène de Noël, qui était dans un style baroque. Je pense à celle des pirates. Dans mon propre film que je m'étais fait, je n'avais pas pu imaginer qu'il nous manquerait de la musique. Et là, nous avons apporté par exemple des musiques de pirates, avec la référence à "La Mer" de Debussy. C'est une petite exception au refus d'avoir recours aux musiques provisoires.
Que pouvez-vous nous dire de l'enregistrement d'orchestre avec l'Orchestre National de Bretagne ?
Pascal Le Pennec : C'est un orchestre magnifique, c'est formidable de travailler dans ces conditions-là, avec ces gens-là, avec cette implication, de gens participant pleinement à un projet cinématographique. On voudrait faire davantage de films pour avoir des moments comme ça. Heureusement, cela se produit, chez moi, une fois tous les 5-6 ans, au mieux.
Pour un cinéaste, assister à un enregistrement, on voit son film décoller ?
Jean-François Laguionie : À ce moment-là, je suis vraiment dans l'émotion. C'est-à-dire que l'image disparaît complètement. Je suis complètement dans l'émotion.
Pascal, vous vous considérez comme un mélodiste ? Est-ce très important que le spectateur ait le thème en tête en sortant du film ?
Pascal Le Pennec : Oui, je pense qu'il y a une grande importance à la mélodie. Et celle-ci disparaît du cinéma depuis des années. Il y a de plus en plus d'ambiances qui sont demandées, parfois à des compositeurs tout à fait capables de faire autre chose, mais qui proposent des ambiances qui relèvent du design sonore, que l'on va ensuite classer sous la mention "musique". C'est comme si les réalisateurs avaient un peu peur de la musique en ce moment. La mélodie, cela raconte aussi quelque chose. J'aime beaucoup l'idée que ce qui est merveilleux dans le cinéma, c'est que des gens puissent sortir de la salle et se souvenir de quelque chose de musical du film. Or, très souvent, on sort de la salle de cinéma, même quand le travail est très bien fait, sans rien de caractéristique musicalement. Ce n'est pas uniquement le compositeur qui se fait plaisir à faire un thème, c'est aussi un enjeu narratif. Dans "Slocum et moi", le thème va se construire avec la construction du bateau. La musique soutient cette progression du récit.
Propos recuellis par Benoit Basirico
dans le cadre du Festival d'animation d'Annecy


Interview B.O : Delphine Malaussena & Hélène Merlin (Cassandre)